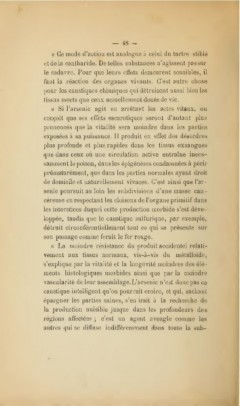Page 50 - My FlipBook
P. 50
— 48 -
« Ce mode d'action est analogue à celui du tartre stibié
et de la cantharide. Dételles substances n'agissent pas sur
le cadavre. Pour que leurs effets demeureut sensibles, il
faut la réaction des organes vivants. C'est autre chose
pour les caustiques chimiques qui détruisent aussi bien les
tissus morts que ceux actuellement doués de vie.
« Si l'arsenic agit en arrêtant les actes vitaux, on
conçoit que ses effets escarotiques seront d'autant plus
prononcés que la vitalité sera moindre dans les parties
exposées à sa puissance. Il produit en effet des désordres
plus profonds et plus rapides dans les tissus exsangues
que dans ceux où une circulation active entraîne inces-
samment le poison, dans les épigénèses condamnées à périr
prématurément, que dans les parties normales ayant droit
de domicile et naturellement vivaces. C'est ainsi que l'ar-
senic poursuit au loin les subdivisions d'une masse can-
céreuse en respectant les cloisons de l'organe primitif dans
les interstices duquel cette production morbide s'est déve-
loppée, tandis que le caustique sulfurique, par exemple,
détruit circonférentiellement tout ce qui se présente sur
son passage comme ferait le fer rouge.
« La moindre résistance du produit accidentel relati-
vement aux tissus normaux, vis-à-vis du métalloïde,
s'explique par la vitalité et la longévité moindres des élé-
ments histologiques morbides ainsi que par la moindre
vascularité de leur assemblage. L'arsenic n'est donc pas ce
caustique intelligent qu'on pourrait croire, et qui, sachant
épargner les parties saines, s'en irait à la recherche de
la production nuisible jusque dans les profondeurs des
régions affectées ; c'est un agent aveugle comme les
autres qui se diffuse indifféremment dans toute la sub-